Philisto > Articles
Articles
Ecrit par AXELG | Vu 37398 fois | Aucun commentaire

Un dictateur est-il nécessairement tyrannique ? Au cur du XXe siècle, le système politique du Portugal délivre à l'analyse politique, l'un de ces despotes éclairés que l'on croyait avoir disparus avec les dernières années du XIXe siècle. Issue d'un pays en banqueroute, malmenée par les menées communistes internes et les philippiques de l'État soviétique, la dictature de l'économiste António de Oliveira Salazar semble imprimer au sein de la rubrique politique un cas unique et à ce jour, encore relativement méconnu par nos contemporains.
Ecrit par AXELG | Vu 19652 fois | Aucun commentaire

De l'histoire de l'Union Soviétique, on se souvient principalement de Joseph Staline (1878-1953) et ce dernier a été stigmatisé comme seul tenant des crimes du communisme. Mais à l'origine, il y avait Lénine. Vladimir Ilitch Oulianov (1870-1924) de son nom complet, nourri aux enseignements de Marx et d'Engels, fut à l'origine de lÉtat qui allait bouleverser, 70 ans durant, la donne de la diplomatie mondiale. Tandis qu'en Russie la mémoire du personnage s'efface des mémoires, au rythme effréné des ans et de la démocratie nouvelle, les individus épargnés par l'héritage communiste croient tout savoir sur Vladimir Lénine. Mais connaît-on réellement cet homme, au crâne chauve et à la barbe châtain, qui passa sa vie à rêver la « révolution sociale » ?
Ecrit par Thibault | Vu 31153 fois | Aucun commentaire

Le métier de bourreau est le fruit de nombreux siècles d'évolution en matière d'exécution des peines : dans les temps les plus anciens, le peuple lui-même exécutait le coupable par lapidation ou d'autres voies. Par la suite, dans la Grèce antique, à Rome et au Moyen Âge, le peuple perdit son rôle actif dans les exécutions capitales pour un rôle passif : par sa présence, il officialisait la mise à mort du condamné, qui sortait physiquement de la communauté, tandis que la charge de l'exécution revenait au seul bourreau, appelé aussi « exécuteur des hautes oeuvres » dans la France moderne.
Ecrit par Thibault | Vu 46254 fois | Aucun commentaire

De la Préhistoire à nos jours, la forêt de l'actuel territoire français a été façonnée par les hommes en fonction de leurs besoins, qu'ils soient agricoles, pastoraux ou industriels. L'histoire des espaces boisés voit ainsi se suivre périodes de destructions, déboisements et friches, acclimations et reboisements, mais aussi protection du patrimoine forestier. Comment les hommes ont adapté la forêt à leurs besoins sur l'actuel territoire français au cours des siècles ? Comment ces hommes ont-ils perçu la forêt ? Quelles ont été les grands rythmes scandant l'histoire de la forêt ?
Ecrit par AXELG | Vu 13701 fois | Aucun commentaire

Dans l'imaginaire collectif, Richard M. Nixon reste l'incarnation du côté sombre de l'Amérique ; une conviction renforcée par le fait que Georges Lucas (créateur du mythe Star Wars) lui-même ait avoué s'être inspiré du 37ème président des États-Unis pour son diabolique personnage de Dark Vador. Mais la réputation fort sulfureuse de Nixon est-elle justifiée ou n'est-elle finalement que le fruit d'une abondante propagande médiatique visant, par le biais d'une affaire d'espionnage, à transformer l'ex-chef d'État en personnage politique le plus haï de son temps ?
Ecrit par Thibault | Vu 19959 fois | Aucun commentaire

Le libéralisme économique du XIXe siècle entraîna au niveau social une situation inédite. La bourgeoisie pouvait pratiquer pratiquement sans obstacle des activités diverses avec une main d'oeuvre pauvre venue de la campagne et s'installant en ville. Cette population de déracinés, soumise dans les grandes manufactures de la seconde moitié du siècle à des conditions de travail d'une grande pénibilité, sans protection, frappa les milieux chrétiens. Les partis politiques au pouvoir au XIXe ne se souciaient pas de la question sociale, cette question sociale relevant selon eux du domaine privé ou caritatif. Plusieurs grands catholiques comme Mgr Affre, René La Tour du Pin et surtout Albert de Mun s'engagèrent contre la lutte pour la pauvreté. Si des initiatives vinrent du clergé, il n'y eu pas cependant de véritable doctrine sociale de l'Eglise avant la parution de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, en 1891.
Ecrit par Thibault | Vu 35035 fois | Aucun commentaire

Depuis la fin du VIIe siècle, la monarchie de Tolède traverse une grave crise tant au niveau politique que social marquée une instabilité dynastique. Les rivalités entre le roi et les aristocrates affaiblissent considérablement la capacité de résistance du royaume tandis qu'une part de la population - juifs et esclaves - a tout intérêt à un changement de pouvoir. En 711, lorsqu'une importante armée de Berbères musulmans traverse le détroit de Gibraltar, le royaume wisigothique est donc particulièrement vulnérable. Tariq ibn Ziyad, à la tête des forces musulmanes, conquiert la péninsule en seulement trois ans avant que des expéditions soient menées en Gaule. La brillante monarchie wisigothique s'effondre après deux siècles d'existence.
Ecrit par AXELG | Vu 65684 fois | Aucun commentaire

Quand on lu à Georges Clémenceau (1841-1929) le testament de son ex-collègue politique Georges Boulanger souhaitant graver sur sa tombe « Marguerite-Georges / Ai-je bien pu vivre deux mois sans toi ? », le futur vainqueur de la Grande Guerre suggéra plutôt : « Ci-gît le général Boulanger qui mourut comme il a vécu. En sous-lieutenant. » Stupéfiante déclaration de Clémenceau qui quelques temps auparavant, avait refusé de continuer à soutenir son ancien condisciple du lycée de Nantes alors chef de file du mouvement qui portait son nom. Le boulangisme fut un feu de paille électoral : ceci dit pourquoi et comment est-il apparu ? Quels étaient ses réseaux ainsi que son objectif ?
Ecrit par Thibault | Vu 12251 fois | Aucun commentaire

La défaite de Napoléon III à Sedan ouvre une période d'incertitudes politiques qui voit une IIIe République proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris, nouveau régime qui n'a pas encore trouvé sa légitimité quand éclate l'insurrection communarde. Après l'armistice signé fin janvier 1871 avec la Prusse, des élections générales doivent se tenir et décider du futur de la guerre (poursuite du conflit ou paix). Le 8 février, les résultats sont très favorables aux monarchistes qui se sont prononcés en faveur de la paix. Adolphe Thiers devient le premier président de la République. Mais la population de la capitale, qui a supporté 4 mois de siège, est ultra-républicaine et voit d'un mauvais oeil ce nouveau gouvernement royaliste qui siège à Bordeaux.
Ecrit par Thibault | Vu 9580 fois | Aucun commentaire

L'Ibérie avant la conquête romaine est un territoire morcelé, divisé en de multiples peuples (Vaccéens, Vettons, Turdetaniens, Cantabres,...) dont les deux principaux sont les Celtibères (au centre de la péninsule) et les Lusitaniens (au centre-ouest). Rome prend pied dans la péninsule lors de la seconde guerre punique (218-202 av. J.-C.), et, suite à sa victoire contre Carthage, commence à mener une politique impérialiste en conquérant une grande partie de l'Ibérie (Sud et Est). La péninsule est pourtant loin d'être domptée et il faudra attendre 133 pour que cessent les hostilités.
Ecrit par Thibault | Vu 32807 fois | Aucun commentaire

La culture populaire est la culture du peuple, lequel est traditionnellement opposé aux élites. Le clivage qui sépare ces deux cultures est néanmoins loin d'être imperméable : la monarchie tente d'harmoniser les cultures « régionales » tandis que les élites tendent à imposer leur manière d'être, caractérisée par la retenue, le contrôle des pulsions et la pudeur. Si le XVIIIe siècle est le siècle du mépris de cette culture populaire, paradoxalement celle-ci suscite l'intérêt à des fins d'apprivoisement, de contrôle des masses.
Ecrit par Thibault | Vu 32008 fois | 2 commentaires
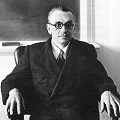
Kurt Gödel constitue l'une des figures les plus marquantes de la logique mathématique au XXème siècle. Le théorème le plus célèbre de Gödel, le théorème d'incomplétude mathématique, constitue une rupture dans l'histoire des idées. Il n'est pas exagéré de dire qu'il est à la logique ce que le cogito cartésien est à la pensée: un principe par rapport auquel tout système doit prendre position.
Ecrit par Thibault | Vu 29119 fois | 3 commentaires

Peu de batailles suscitent autant l'intérêt que celle de Waterloo, qui marque la fin définitive de l'Empire napoléonien. Revenu en France après un court exil sur l'île d'Elbe, Napoléon réorganisa le régime politique de la France et adressa des offres de paix aux autres souverains européens. Mais ceux-ci ne purent visiblement pas supporter de voir le dangereux aigle impérial à nouveau sur le trône et organisèrent l'invasion de la France. Napoléon entra en Belgique pour donner ce qu'il souhaitait être un grand coup de bélier. Le sort des armes conduisit au désastre militaire, et sur le banc des accusés figure en premier chef, Grouchy.
Ecrit par Thibault | Vu 20222 fois | Aucun commentaire
Avec la chute de l'Empire romain le statut de la femme en Occident se transforme considérablement. Au IVe siècle, Constantin, premier empereur chrétien, avait abrogé les lois d'Auguste sur le mariage, en octroyant aux femmes célibataires de 25 ans ou plus un contrôle illimité sur leurs biens et leurs personnes. A la fin de l'Empire, le Christianisme permet aux femmes de se considérer comme des personnes autonomes et non plus uniquement comme des filles, épouses, ou mères. Les femmes deviennent les plus sûrs soutiens de l'Eglise primitive, baptisant leurs enfants et convertissant leurs maris. De l'autre côté du limes (la frontière), la condition des femmes était bien différente. On distinguait ainsi trois types de mariage : le mariage par achat (Kaufehe), le mariage par rapt (Raubehe) et le mariage par consentement mutuel (Friedelehe). La femme adultère subissait la flagellation et l'enterrement vivant. La condition des femmes durant le haut Moyen Âge (Ve-Xe siècle) est une synthèse entre le droit romain et les coutumes barbares, la condition allant tout de même en s'améliorant au cours des siècles.
Ecrit par Thibault | Vu 8131 fois | Aucun commentaire

Le 21 mai 2001 a été promulguée la loi Taubira, reconnaissant la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. L'article 1er affirme que « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité ». La loi semble oublier que la traite des esclaves était pratiquée de tous temps et par tous les peuples. La traite ne commence pas au XVe siècle et la culpabilité ne repose pas uniquement sur les pays occidentaux ! En effet, il existe une autre traite majeure, bien moins souvent évoquée : la traite négrière pratiquée par les musulmans, laquelle dura plus de mille ans (VIIe-XXe siècles), précédant celle des Européens et lui survivant.
Une inscription est nécessaire pour pouvoir proposer un article !
C'était un 21 Mars
Evènement : En 1804, Napoléon Bonaparte promulgue le Code civil (ou « Code Napoléon »).
Naissance de : Jules Favre, homme politique français (1809-1880).
Décès de : Nadar, né Félix Tournachon, photographe français (1820-1910).
Naissance de : Jules Favre, homme politique français (1809-1880).
Décès de : Nadar, né Félix Tournachon, photographe français (1820-1910).
| Top 3 du concours du mois |
|---|
Sondage
Vous êtes ...
Digital discoveries
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne Francais
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne France
- Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne France
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne Fiable
- Meilleur Casino En Ligne Français
- Meilleur Site Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne Avis
- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat
- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat
- Meilleur Casino En Ligne France
- Meilleur Casino En Ligne Français
- Meilleur Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne De France
- Meilleur Casino En Ligne
- Meilleur Site De Casino En Ligne
- Sweet Bonanza Fruits Avis
- Paris Sportif Ufc Mma
- Casino En Ligne Fiable
- Meilleur Casino En Ligne France
- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne
- Bonus Sans Depot Casino
- Meilleur Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne
- Meilleure Casino En Ligne
- Meilleur Nouveau Casino En Ligne
